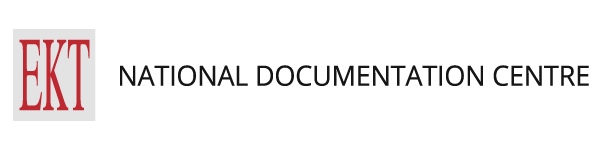Appel à contribution pour le dossier thématique (La didactique du rythme en enseignement/apprentissage du FLE)
Numéro thématique de la revue,
coordonné par Florentina Fredet, Christos Nikou et Sandrine Wachs
Titre :
La didactique du rythme en enseignement/apprentissage du FLE
Argumentaire
« Le rythme parolier constitue le fondement de l’architecture sonore d’une langue » (Billières, Au son du fle). D’emblée, nous entendons le terme rythme au sens large, intégré à la prosodie et couvrant l’organisation temporelle et mélodique de la parole (débit, durées, accentuation, pauses, contours intonatifs), ainsi que leurs effets perceptifs et interactionnels. Nous reconnaissons toutefois la pluralité des acceptions en usage (rythme, prosodie, mélodie, « musique de la langue »), pluralité qui pourra dans ce numéro être interrogée. Élément central de toute langue vivante, le rythme se situe au cœur des dynamiques communicationnelles orales. En français, le rythme structure à la fois le plan linguistique (à tous les niveaux), le plan interactionnel/sociolinguistique et le plan culturel. Pourtant, en didactique du Français langue étrangère (FLE), son traitement demeure souvent marginal, limité à des exercices ponctuels de prononciation (« écoutez et/ou répétez », « identifiez si chaque phrase est une déclaration, une interrogation ou une exclamation ») ou à la lecture à voix haute.
Le Volume complémentaire (2018) du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) réorganise la rubrique « Maîtrise phonologique » (et non « phonétique », la phonologie renvoyant aux unités pertinentes et aux règles de fonctionnement du système abstrait) en trois catégories : maîtrise générale du système phonologique – qui, dans sa formulation actuelle, relève surtout de l’évaluation de l’intelligibilité et de l’effort perçu par l’auditeur, tout en laissant en retrait la phonotactique, la syllabation, la coarticulation, la morphophonologie ou encore la perception –, articulation isolée des sons et traits prosodiques. Dans ce cadrage parfois flou, l’accent est néanmoins mis sur la capacité « à utiliser de façon efficace les traits prosodiques afin de transmettre du sens d’une manière de plus en plus précise » (CECRL, 2018, p. 141). Les notions clés mentionnées portent sur « la maîtrise de l’accent tonique, de l’intonation et/ou du rythme » et sur la « capacité à utiliser et/ou à varier l’accent et l’intonation pour souligner un message particulier » (ibid.). La formulation « et/ou du rythme » questionne le statut conféré au rythme au sein des traits prosodiques ; le présent numéro invite à clarifier ce statut par des critères et des tâches opérationnels plutôt que normatifs. Par ailleurs, l’échelle indique qu’au niveau A1 « [il y a] une forte influence de l’accent, du rythme et/ou de l’intonation de l’une ou l’autre des langues que [l’apprenant] parle » (CECRL, 2018, p. 142), tandis qu’au niveau B2 l’influence des autres langues demeure « notable » (ibid.). Cette persistance renforce la nécessité d’une didactisation explicite et graduée du rythme dans les curricula et les ressources, alors que les manuels de FLE abordent rarement de façon systématique les phénomènes prosodiques et, plus rarement encore, le rythme comme objet d’enseignement structuré.
Plusieurs ouvrages de référence ont balisé le champ, notamment Bertrand Lauret (Enseigner la prononciation du français : questions et outils, Paris, Hachette, coll. « f », 2007) et Dario Pagel, Édith Madeleni et François Wioland (Le rythme du français parlé, Paris, Hachette FLE, coll. « f », 2012). Des travaux plus récents confirment l’intérêt d’articuler cadrage épistémologique, dispositifs didactiques et outillage technopédagogique : Sophie Aubin (2022[1]) dresse un panorama des pratiques actuelles centrées sur le rythme et identifie les obstacles d’intégration curriculaire ; Sylvain Detey et Jacques Durand (2021[2]) précisent les leviers et contraintes de l’acquisition de la prononciation en L2 ; Grégory Miras (2019 ; 2021[3]) interroge la doxa terminologique et propose un déplacement « de la correction à la médiation », aux conséquences directes pour la place du rythme en classe.
Ce numéro thématique a pour objectif de dresser un état des lieux de la place du rythme en FLE, d’en interroger les enjeux et d’en renouveler les usages dans les pratiques d’enseignement/apprentissage, selon une double perspective articulant cadres théoriques, réflexions didactiques et expérimentations pédagogiques. Le rythme linguistique ne se limite pas à la prosodie ; il engage également des représentations culturelles, des habitudes perceptives, des formes d’expression corporelle et artistique (musique, poésie, théâtre, danse, slam, etc.) ainsi que des processus d’acquisition du langage. Il constitue à la fois un objet linguistique à étudier, un outil didactico-pédagogique à mobiliser et un levier pour développer la compétence orale et l’intelligibilité des apprenants.
Ce numéro se propose donc de rassembler les contributions autour des axes suivants :
Axe 1 : Cadrage théorique (et définitoire)
- Analyses linguistiques et phonoprosodiques du rythme en français : accentuation, isochronie, groupements rythmiques, etc. ;
- Perspectives contrastives : le rythme du français comparé à d’autres langues (notamment langues maternelles des apprenants) ;
- Cadres théoriques mobilisables en didactique du rythme : phonologie de l’usage, approche actionnelle, perspective cognitive, sociolinguistique du rythme ;
- Le rythme comme fait culturel et identitaire : implications pour la compétence interculturelle ;
- Le rôle du rythme dans la compréhension orale et l’acquisition phonologique.
- Articulation entre rythme et fluidité dans la production orale ;
- Rôle du rythme dans la compréhension orale et la segmentation du discours ;
- Le rythme comme support pour la mémorisation lexicale et syntaxique ;
Axe 2 : Réflexions didactiques
- Objectifs et progression : définir des objectifs opérationnels liés au rythme (intelligibilité, compréhensibilité, fluidité, adéquation pragmatique, du A1 au C2) ; proposer des jalons de progression (spirales d’apprentissage, réactivation) et l’articulation avec compréhension, production et interaction orales.
- Conception curriculaire : positionner le rythme dans les curricula (volumes horaires, séquences, transversalité avec musique/théâtre).
- Typologie de tâches & scénarios-cadres : définir des familles de tâches (sensibilisation, entraînement, transfert en interaction) et leurs variables didactiques (durée, guidage, étayage, complexité) ; proposer des scénarios-cadres (formats génériques) adaptables aux niveaux et publics.
- Remédiation & différenciation : stratégies de remédiation rythmique non stigmatisantes (ciblage de contrastes, entraînement au tempo/pauses) ; adaptations pour publics ciblés (alphabétisation, sinophones, nipponophones, hellénophones, etc.) et prise en compte des profils L1.
- Formation des enseignant·e·s : gestes professionnels pour enseigner le rythme (modélisation, guidage, mise en voix, gestion du tempo).
- Recherche et preuves d’efficacité : dessins de recherche appliquée (quasi-expérimentations, études de cas, corpus d’apprenants) et mesures d’effet ; transférabilité et limites (contextes, tailles d’échantillon), articulation avec les axes 1, 3, 4 et 5.
Axe 3 : Pratiques pédagogiques
- Séquences pédagogiques intégrant le rythme à travers des activités multimodales : théâtre, chant, musique, slam, poésie, body percussions, etc. ;
- Exploitations pédagogiques du rythme dans les supports authentiques : chansons, dialogues, podcasts, documents audiovisuels ;
- Dispositifs de remédiation phonétique et rythmique pour des publics ciblés (alphabétisation, apprenants sinophones, nipponophones, hellénophones, etc.) ;
- Évaluation de la compétence rythmique : quels critères ? Quelles pratiques ?
- Pratiques d’oralité rythmée : récitation, reformulation, jeux oraux, lecture expressive ;
- Travail pédagogique du rythme dans l’interaction orale : gestion des tours de parole, des chevauchements, des silences et des hésitations.
Axe 4 : Apport des nouvelles technologies : visualiser, entraîner, évaluer
- Cadrage et métriques : durée, F0, intensité, syllabation, accent de groupe, enchaînement/liaison ; visualisation/annotation pour rendre le rythme observable et objectivable ;
- Entraînement assisté : reconnaissance/synthèse de la parole (ASR/TTS), feedback automatisé, tuteurs intelligents et tableaux de bord (tempo, pauses, régularité) ; validation des scores par rapport aux jugements humains ;
- Dispositifs immersifs et mobiles : micro-apprentissages sur smartphone, AR/VR, capteurs de mouvement pour la synchronisation geste-parole ; scénarios de shadowing, lecture rythmée, karaoké prosodique ;
- Corpus et standards : constitution de corpus d’apprenants, schémas d’annotation prosodique, interopérabilité et reproductibilité ; partage de ressources ouvertes ;
- Approches technopédagogiques du rythme : utilisation d’outils numériques (logiciels de visualisation de la prosodie, karaokés interactifs, applications mobiles, etc.).
Axe 5 : Environnements plurilingues et pluriculturels
- Sensibilité rythmique des apprenants en fonction de leur langue première ;
- Transferts rythmiques entre langues : interférences, complémentarités, zones de difficultés ;
- Le rythme comme point d’appui pour une didactique inclusive en contexte migratoire ou hétérogène ;
Échéancier
Les propositions comprendront un résumé de 300–500 mots assorti de cinq mots-clés et indiqueront l’axe principal visé (un seul) et, le cas échéant, un axe secondaire.
Date limite pour l’envoi d’une proposition : 31 janvier 2026
Sélection des propositions par le comité scientifique : 28 février 2026
Réception des articles : 31 octobre 2026
Notification de l’acceptation de l’article (avec prise en compte des commentaires du comité scientifique) : 31 janvier 2027
Publication du numéro : mars 2027
Les propositions devront être envoyées en fichier joint (format Word), conjointement aux deux adresses suivantes : [email protected] et [email protected]
[1] Sophie Aubin, « Didactique et méthodologie du rythme du français pour apprenants adultes : Un état des lieux et des perspectives », Journal for Foreign Languages, 14(1), 2022 p. 177-195.
[2] Sylvain Detey et Jacques Durand, « L’acquisition de la prononciation en langue étrangère », in P. Leclerc, A. Edmonds & E. Sneed (dir.), Introduction à l’acquisition des langues étrangères, Bruxelles, De Boeck Université, 2021, p. 111-123.
[3] Grégory Miras, Grégory Miras, « De la correction à la médiation : la doxa terminologique en didactique de la prononciation du français comme langue étrangère », Recherches en didactique des langues et des cultures [Online], 16-1 | 2019. URL: http://journals.openedition.org/rdlc/4298; DOI: https://doi.org/10.4000/rdlc.4298 ; id., Didactique de la prononciation en langues étrangères, de la correction à une médiation, Paris, Didier, coll. « Langues et didactique », 2021.